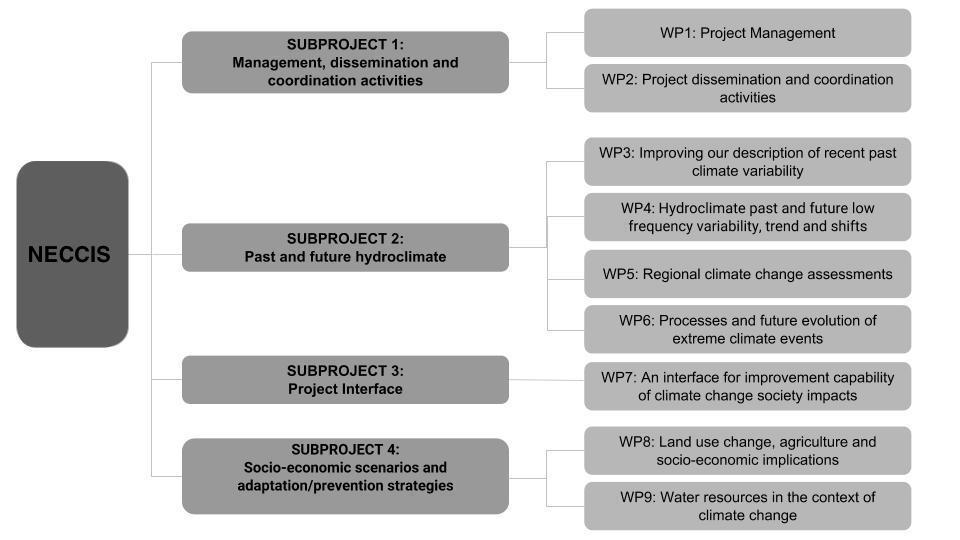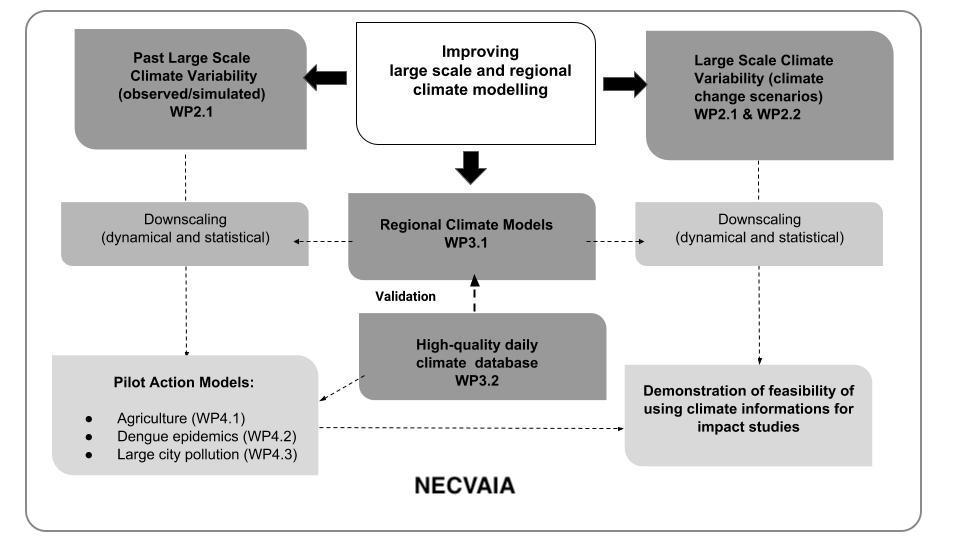SLIM Assen
Économiste, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Centre de recherche Europes Eurasie (CREE – EA 4513), Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA – UMR 245).
ARDD-1-2021 – Développement durable : recherches en actes
Durabilité et globalisation : approches théoriques et critiques
Pour citer cet article
SLIM Assen : « Croissance verte et décroissance : deux visions extrêmes de la durabilité », Actes de la recherche sur le développement durable, n°1, 2021.
ISSN : 2790-0355 (version en ligne) — ISSN : 2790-0347 (version imprimée)
URL : https://publications-univ-sud.org/ardd/2021/12/521/
DOI : (à compléter)
Texte intégral
Croissance verte et décroissance : deux visions extrêmes de la durabilité
par Assen SLIM
Version PDF
Les interrogations autour de durabilité du développement économique émergent lors de la conférence du PNUD à Stockholm (1972) sous l’appellation d’« écodéveloppement ». Quelques années d’aggravation des pollutions et des inégalités mondiales plus tard, la notion est consacrée sous le terme de « développement durable » dans le rapport Brundtland (1987) : le développement serait durable s’il arrivait à allier efficacité économique, respect de la nature et répartition équitable des richesses. Une telle définition ne va pas sans appeler à une série d’éclaircissements. En premier lieu, les trois pôles de la durabilité ainsi exprimés sont-ils de nature à pouvoir être conciliés ? En deuxième lieu, quels sont les mécanismes de transmission par lesquels ces trois pôles interagissent entre eux ? Enfin, quels sont les hypothèses implicites qui sous-tendent cette vision de la durabilité ?
A ces questions, le rapport Brundtland répond que le développement durable, « c’est une nouvelle ère de croissance économique, une croissance vigoureuse et, en même temps, socialement et environnementalement durable » (Brundtland, 1987, p. 4). Cette approche, appelée plus tard « croissance verte et inclusive » s’est imposée progressivement. La conférence de Rio (1992), en lui donnant un contenu pratique avec l’Agenda 21, a permis son adoption à large échelle. Toutefois, face à l’aggravation continue du réchauffement atmosphérique, à l’épuisement des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, à la réduction alarmante de la biodiversité, aux crises économiques et financières à répétition et aux échecs des grandes rencontres internationales sur le sujet, d’aucuns ont appelé à un renouvellement complet de la notion de durabilité. L’approche initiée par Mme Brundtland, désormais qualifiée de vision « faible » de la durabilité, doit désormais compter avec des visions alternatives dites « fortes » de la durabilité : l’économie écologique et la décroissance. La première définit des seuils à ne pas dépasser dans l’exploitation de la nature tandis que la seconde rejette radicalement toute forme d’exploitation de la nature.
Nous porterons notre attention sur la seconde, en nous demandant si cette alternative, pour radicale qu’elle soit, porte un projet viable et réalisable de durabilité.
Cet article se propose d’apporter des éléments de réponse à cette question en revenant sur les hypothèses implicites de la vision faible de la durabilité, puis en mettant en lumière les limites de cette approche, avant d’établir une distinction entre économie écologique et décroissance, pour enfin analyser ce dernier courant.
La vision faible de la durabilité
La réflexion sur la durabilité, initiée en 1972 autour de la notion d’« écodéveloppement », donne naissance dans les années 1980 au concept de « développement durable ». Ce dernier repose sur deux hypothèses (substituabilité des facteurs et progrès technique) qui conduisent à envisager la durabilité sous l’angle de la croissance verte, la poursuite de la mondialisation, la croissance maîtrisée de la démographie et la réduction des déchets. En conséquence, cette vision de la durabilité est qualifiée de « faible ».
L’émergence de la vision « faible » de la durabilité
Dès le tout début de la révolution industrielle, des réflexions sont menées sur le lien entre l’émission de gaz à effet de serre et le réchauffement de l’atmosphère. Des auteurs comme Fourier, Tyndall ou Arrhenius établissent rapidement ce lien : « un doublement de la quantité de dioxyde de carbone dans l’air se traduirait par une hausse des températures de 5 à 6°C » (Arrhenius, 1896, p. 266).
Moins d’un siècle plus tard, la notion d’« écodéveloppement » voit le jour lors de la conférence organisée par le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) en juin 1972. Deux plans d’action sont alors définis : l’un concerne la lutte contre les pollutions, l’autre porte sur la lutte contre le sous-développement. La même année, le Programme des nations unies pour l’environnement (PNUE) est créé. Il est chargé de surveiller les modifications notables de l’environnement et de coordonner les efforts mondiaux de préservation de ce dernier.
Les préoccupations relatives aux « générations à venir » voient le jour en 1980, dans Nord-Sud : un programme de survie, rapport réalisé par une commission indépendante présidée par W. Brandt. L’expression « développement durable » (sustainable development) apparaît pour la première fois en 1980, dans un ouvrage intitulé Stratégie mondiale de la conservation et publié par l’Union internationale de la conservation de la nature (UICN)[1]. S’articulant autour des mêmes valeurs que l’écodéveloppement, le développement durable s’impose définitivement en 1987 avec le rapport dit « Brundtland » du nom de la Première ministre de Norvège de l’époque, Gro Harlem Brundtland, à qui l’ONU avait commandé un état des lieux dès 1983. Deux idées fortes y sont défendues : une reprise de la croissance économique mondiale est nécessaire ; les effets négatifs de cette dernière sur l’environnement peuvent largement être évités. Il en découle l’une des définitions suivantes : « le développement durable, c’est de s’efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures » (Brundtland, 1987, p. 37). La conférence de Rio de 1992 donne corps à cette définition en adoptant deux textes fondateurs de la notion de durabilité : d’une part, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement qui pose 27 principes d’ordre général et d’autre part, un document de propositions, non juridiquement contraignant, mais qui fait autorité, à savoir l’Agenda pour le XXIe siècle, dit « Agenda 21 ». Les engagements pris à Rio se déclinent jusqu’à nos jours en plusieurs conférences internationales spécialisées par thèmes : transport des déchets toxiques à Bâle en 1992, population au Caire et développement social à Copenhague en 1994, droits des femmes à Pékin en 1995, habitats humains à Istanbul en 1996, émissions de gaz à effet de serre à Kyoto en 1997, etc.
La notion de durabilité, telle que définie dans le cadre du développement durable, est une recherche de conciliation entre efficacité économique, respect de la nature et répartition équitable des richesses. Elle repose sur des hypothèses implicites qu’il convient de présenter.
Les deux hypothèses de la vision « faible » de la durabilité
D’après Brundtland, la croissance est « absolument indispensable pour soulager la misère qui ne fait que s’intensifier dans une bonne partie du monde en développement » (Brundtland, 1987, p. 7). Cette nouvelle ère de croissance repose implicitement sur deux hypothèses fortes : la substituabilité des facteurs et la diffusion rapide du progrès technique.
La substituabilité totale des facteurs postule que les ressources naturelles détruites peuvent être en permanence remplacée par du capital technique (machines) ou du facteur travail. La nouvelle ère de croissance implique « des dommages inévitables causés à l’environnement par l’extraction et la transformation des ressources » (ibid., p. 175). Cette croissance ne peut être envisagée dans une optique de durabilité (respect des générations futures) qu’à la seule condition qu’il soit possible de remplacer la nature détruite par des machines et/ou du travail humain : « Il nous faudrait des techniques capables de produire des biens “sociaux” (de l’air moins pollué, des produits qui durent plus longtemps) ou de résoudre des problèmes dont les entreprises ne calculent jamais le coût » (ibid., p. 53).
Cette conception brundtlandienne de la durabilité prend rétrospectivement appui sur les travaux des économistes Solow et Hartwick. Partant de la règle définie par H. Hotelling, en 1931, selon laquelle toute ressource épuisable (Hotelling travaillait sur la gestion optimale d’un gisement minier) voit son prix augmenter au cours de son exploitation pour atteindre, à l’épuisement, un niveau tel que la demande est nulle, ces auteurs se sont interrogés sur la notion d’équité intergénérationnelle. Le critère d’équité retenu ici est, d’après Solow, « que la consommation par tête soit constante à travers le temps de façon qu’aucune génération ne soit favorisée par rapport à une autre » (Solow, 1974, p. 1). Or, comment peut-il y avoir équité intergénérationnelle lorsque les ressources naturelles s’épuisent dans le temps et que leurs prix augmentent ? La réponse des auteurs est claire : il y aura équité lorsque « la génération présente convertit des ressources épuisables en machines et vit des flux courants provenant des machines et du travail » répond Hartwick. En d’autres termes, les ressources naturelles détruites par une génération peuvent toujours être compensées par du capital technique légué aux générations suivantes. Ainsi « aucun stock ou de machines, ou de ressources épuisables ne sera jamais épuisé » (Hartwick, 1977, p. 972). Conclusion reprise et enrichie par Solow qui pose, en 1986 (un an avant la remise du rapport Brundtland), les trois conditions de la durabilité (Solow, 1986, p. 144) : utilisation de tout le capital et de tout le travail disponible, augmentation du prix des ressources épuisables à mesure de leur exploitation (Hotelling), investissement en capital technique des rentes et des profits obtenus par l’exploitation des ressources épuisables (Hartwick). Suivant ce raisonnement, l’inévitable destruction de la nature pourrait être indéfiniment compensée par des mécanismes artificiels inventés par chaque génération. Ainsi, d’après Solow, la disparition de certaines ressources naturelles ne constituerait pas une « catastrophe », mais un « événement » (Solow, 1974, p. 11).
La durabilité appelle une nouvelle ère de progrès technique, car la « nouvelle ère de croissance économique devra nécessairement se montrer moins fortement consommatrice d’énergie que l’ère précédente » (Brundtland, 1987, p. 19). Le progrès technique, consistant « à rendre plus efficace l’utilisation de l’énergie » (ibid., p. 19) va dans le bon sens. Brundtland détermine des objectifs : « Les progrès à réaliser dans ce domaine sont nombreux. La conception des appareillages modernes peut être revue de telle façon que l’on obtienne les mêmes performances en ne consommant que les deux tiers, ou même la moitié, de l’énergie requise pour faire fonctionner les équipements classiques » (ibid., p. 19). Enfin, la diffusion des innovations doit se faire rapidement. Ainsi, « le progrès dont certains ont profité depuis un siècle pourra s’étendre à tous dans les années à venir » (ibid., p. 30) et en priorité aux pays en développement (PED) : « Il faut renforcer la capacité d’innovation technologique des pays en développement afin que ceux-ci soient mieux armés pour relever le défi du développement durable » (ibid., p. 53). Il est ainsi prôné des transferts gratuits de technologies adaptées aux problèmes des PED.
Cette vision « faible » de la durabilité soulève un grand nombre d’interrogations et d’incertitudes qui font toutes l’objet de débats. Ce sont les « objets encombrants » du développement durable, présentées sommairement ci-dessous.
Les objets encombrants du développement durable
• Le développement durable et la mondialisation
D’après Brundtland, « une nouvelle ère de croissance dépend d’une gestion économique efficace […] de nature à faciliter l’expansion, à réduire les taux d’intérêt réels et à arrêter le glissement vers le protectionnisme » (Brundtland, 1987, p. 65). La mondialisation, perçue comme la généralisation du libre-échange au monde entier, constitue un changement d’échelle par rapport à l’intégration régionale. On y retrouve les interrogations sur l’efficacité supposée de l’union des marchés et les mêmes constats d’échec tant en matière économique que sociale et environnementale. Cela amène Stiglitz, par exemple, à conclure que « la mondialisation, ça ne marche pas. Cela ne marche pas pour les pauvres du monde, ça ne marche pas pour l’environnement, ça ne marche pas pour la stabilité de l’économie mondiale » (Stiglitz, 2002, p. 235) et l’auteur de dénoncer le comportement prédateur des firmes multinationales (FMN), l’inégale distribution des gains liés au commerce, la « course vers le fond » en termes de conditions sociales, les pollutions exponentielles, etc.
Les défenseurs de la vision faible de la durabilité font valoir que, même marginales, des évolutions existent qui surmontent cette apparente contradiction entre libre-échange mondial et développement durable. Ces évolutions constituent de nouveaux facteurs de concurrence et de différenciation pour les entreprises. On peut citer l’évolution perceptible de la demande des consommateurs des pays industrialisés vers des produits éthiques et responsables, la progression de l’investissement socialement responsable (ISR), les opérations de communication issues de la société civile et l’intensification des contraintes réglementaires nationales. Certains voient ces évolutions comme une inflexion nouvelle qui incite les entreprises à adopter des stratégies relevant de la Responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) tout en garantissant la sauvegarde de leurs profits.
Les défenseurs de la vision faible de la durabilité soulignent également la proximité entre le développement durable et le commerce équitable qui émerge à partir des années 1970. Ce type particulier de commerce à la fois rentable pour les entreprises, soucieux de garantir des revenus stables pour les producteurs et intégrant des normes environnementales, constitue un point de rencontre entre l’intégration par les marchés (libre-échange mondial) et le développement durable. En effet, les producteurs/transformateurs (des PED) sont tenus de respecter des critères économiques (quantités et qualités adaptées aux marchés occidentaux), des critères sociaux (respect des droits de l’homme, des conditions de travail) et environnementaux (respect des sols, de l’air, etc.). Les distributeurs (des pays industrialisés) doivent, quant à eux, assurer la viabilité économique du commerce équitable. Remarquons cependant que le commerce équitable reste une pratique marginale puisqu’il porte sur un petit nombre de produits et concerne environ 10 millions de personnes bénéficiaires (pour 150 000 organisations de producteurs/trices dans le monde) ce qui amène Ballet et de Bry à considérer que « l’impact global du commerce équitable est quasi nul » (Ballet & de Bry, 2001, p. 36).
• Le développement durable et la démographie
« Le développement durable n’est donc possible que si la démographie et la croissance évoluent en harmonie avec le potentiel productif de l’écosystème » (Brundtland, 1987, p. 14). La croissance démographique peut aller de pair avec le développement durable à condition qu’elle se fasse à un rythme et dans des proportions compatibles avec la croissance économique et le progrès technique. Brundtland en appelait à une croissance « maîtrisée » de la démographie afin d’en éviter l’« explosion » qui rendrait impossible la satisfaction des besoins de tous.
Dans les faits, on constate une évolution de la problématique démographique en raison du ralentissement de l’accroissement naturel de la population mondiale (2 % en 1965, 1,7 % en 1980, 1,3 % en 2000, 1 % en 2020 et 0,5 % prévu en 2050)[2]. Cette tendance est renforcée par la baisse globale de la fécondité mondiale (ramenée à 2,8 enfants par femme contre 6 dans les années 1960). Il en ressort de nouvelles dynamiques entre population et développement durable. La première dynamique porte sur l’exode rural. Plus marqué dans les PED, il entraîne désertification des régions rurales et constitution de mégapoles. La désertification, à l’origine de la stagnation économique des campagnes, accroît considérablement la vulnérabilité des populations rurales restantes. L’urbanisation (la moitié de la population mondiale est urbaine depuis 2005) entraîne, pour sa part, des effets environnementaux et sociaux délétères lorsqu’elle n’est pas accompagnée de politiques urbaines adaptées. Dans la plupart des villes des PED, par exemple, et en particulier celles qui dépassent les quinze millions d’habitants (Mexico, Shanghai, Bombay, São Paulo) les services de base ne sont pas assurés pour tous (logement, eau, énergie, évacuation des déchets…) et les ressources environnementales sont épuisées par d’importantes ceintures de bidonvilles. La deuxième dynamique est relative au vieillissement des populations, perceptible tant dans les pays développés que dans les PED. L’augmentation de l’espérance de vie et la baisse de la fécondité sont à l’origine de ce phénomène. Selon les projections les plus récentes de l’ONU, le taux de dépendance (personnes de plus de 60 ans par rapport à la population active) devrait plus que doubler d’ici à 2050. L’effectif total des personnes âgées (+ de 60 ans) devrait atteindre 1,970 milliard de personnes en 2050 contre 605 millions en 2000 (Mirkin & Weinberger, 2001, p. 53). Cette évolution est susceptible de déstabiliser les pratiques redistributives dans chaque pays : financement des retraites, soins de santé, aides sociales aux personnes âgées, systèmes familiaux de solidarité… On peut dire que cette dynamique remet en cause l’« intégration nationale » au sens de Myrdal (Myrdal, 1958, p. 67).
• Le développement durable et la réduction des déchets
Le développement durable appelle « à maîtriser la pollution et la production de déchets, à recourir d’avantage au recyclage et à la réutilisation et à réduire au minimum la quantité de déchets dangereux » (Brundtland, 1987, p. 174). L’industrialisation, la consommation de masse, l’urbanisation, se sont traduits par une augmentation presque illimitée des volumes et des variétés de déchets rejetés. Ces derniers provoquent des nuisances (de l’air, de l’eau, des sols) persistantes et globales, affectant la Terre dans son ensemble. La « gestion rationnelle » des déchets préconisée par le rapport Brundtland s’impose comme une solution de bon sens pour accompagner la nouvelle ère de croissance. L’Agenda 21 (1992) définit sur quatre chapitres le contenu de cette gestion rationnelle : « la maîtrise effective de la production, du stockage, du traitement, du recyclage et de la réutilisation, du transport, de la récupération et de l’élimination des déchets dangereux est de la plus haute importance pour la santé de l’homme, la protection de l’environnement, la gestion des ressources naturelles et un développement viable » (UN, 1992, p. 241).
Toutefois, ces engagements peinent à trouver leur réalisation concrète. La convention de Bâle (1992), par exemple, censée interdire les exportations de produits toxiques des pays développés vers les PED, est régulièrement contournée. Bensebaa et Boudier observent que malgré la multiplication des législations, les exportations de déchets dangereux sont massives et en constante augmentation : ils représenteraient désormais 10 % du fret maritime mondial (Benseeba & Boudier, 2008, p. 2). Les déchets électriques et électroniques (DEEE), par exemple, massivement exportés vers l’Asie (80 % des DEEE totaux), sont la plupart du temps incinérés ou enfouis (ibid., p. 4).
Deux pratiques émergent à partir des années 1990 semblant surmonter la contradiction entre le développement durable et l’augmentation des déchets : l’écologie industrielle et l’économie de la fonctionnalité.
L’écologie industrielle, d’abord, établit une analogie entre les systèmes industriels et les écosystèmes naturels. Comme l’explique Erkman, « il est possible d’envisager le système industriel comme un cas particulier de l’écosystème » car « le système industriel tout entier repose sur les ressources et les services fournis par la biosphère dont il constitue en quelque sorte une excroissance » (Erkman, 2004, p. 6). L’écologie industrielle entend donc « déterminer les transformations susceptibles de rendre le système industriel compatible avec le fonctionnement “normal” des écosystèmes biologiques » (ibid., p. 13). L’une de ces transformations consiste à essayer de « boucler » les cycles : les déchets d’une industrie devenant les ressources d’une autre. Se développent ainsi de nombreux parcs industriels obéissant à cette logique (comme celui de Kalundborg au Danemark, par exemple).
L’économie de la fonctionnalité, ensuite, « pose un autre rapport aux produits, celui de l’usage et non plus de la possession » (Bourg, 2002, p. 6). Cette nouvelle pratique part d’une réflexion sur la durabilité des biens et cherche à substituer un « toujours plus durable » au « toujours plus jetable ». L’un des moyens envisagés consiste à modifier les intérêts des industriels en les poussant, non pas à vendre, mais à louer leurs produits. Les profits les plus importants viennent alors des services d’usage et de maintenance (comme c’est déjà le cas pour les producteurs de photocopieuses ou d’imprimantes par exemple). L’économie de la fonctionnalité s’inscrit dans la perspective du développement durable car les producteurs sont amenés à concevoir des biens à durée de vie longue et à limiter gaspillages et déchets.
Vers des visions « fortes » de la durabilité
Les deux hypothèses implicites du développement durable sont remises en cause. Leur rejet ouvre la voie à des approches alternatives de la durabilité appelée désormais « forte ». Deux grands courants émergent : l’économie écologique et la décroissance.
L’indétermination des hypothèses implicites du développement durable
L’hypothèse de substituabilité totale des facteurs (Solow, Hartwick) impose d’être en mesure d’estimer la valeur des actifs naturels détruits afin d’évaluer le montant en capital technique à léguer aux générations futures pour leur garantir un niveau de consommation par tête équivalent au nôtre. L’orientation générale des politiques publiques en matière de développement durable et de protection de l’environnement amène à s’interroger non plus sur l’estimation des dommages et autres externalités négatives subis par la nature, mais bien directement sur l’évaluation monétaire des actifs environnementaux. En d’autres termes, il s’agit de donner un prix à la nature. C’est avec l’évaluation monétaire des dommages environnementaux causés par des accidents (pétroliers en particulier) que différentes méthodes ont vu le jour : méthode par le coût de remise en état des sites avec l’Amoco Cadiz (1978) ; méthode dite des évaluations contingentes et celle des prix hédonistes avec l’Exxon-Valdez (1989) ; méthode du coût de transport avec l’Erika (1999). Toutefois, nombre de difficultés se posent tant sur les fondements mêmes de la notion de valeur que sur les méthodologies empiriques utilisées.
Premièrement, un seul et même actif naturel ne répond pas à un, mais à de multiples besoins simultanés : « attribuer certains services environnementaux à certains usages, c’est s’interdire de voir ces mêmes services utilisés dans d’autres emplois » (Point, 1998, p. 13). L’expression simultanée de ces besoins peut même se révéler source de conflit (l’usage par les uns peut affecter les usages possibles pour les autres) ce qui rend d’autant plus difficile le partage de ces actifs. Notons d’ailleurs que tous les besoins ne sont pas forcément exprimés simultanément. La valeur d’un actif environnemental est donc très relative puisqu’elle ne peut être évaluée qu’à l’aune du besoin auquel l’actif répond. À titre d’exemple, une forêt peut potentiellement répondre à de multiples besoins : loisirs, exploitation des ressources autres que le bois (cueillette de champignons, ramassage de châtaignes, etc.), exploitation du bois (papier, meubles), fixation du carbone, habitat éventuel pour des populations autochtones, usages futurs non exprimés pour le moment (Prieto & Slim, 2009, p. 22).
Deuxièmement, une partie des actifs naturels (l’atmosphère par exemple) a un caractère indivisible. Leur appropriation est en principe impossible et il y a absence de choix quant à la qualité souhaitée. Ces caractéristiques conduisent à l’impossibilité d’affecter des droits de propriété. Autrement dit, ces biens échappent à toute procédure d’évaluation marchande. L’échange marchand est donc exclu. Les mécanismes de marché de droits à polluer tentent de surmonter cette absence de droits de propriété en attribuant des droits d’usage. La démarche consiste à fixer un niveau d’émissions de polluants pour une période et une zone géographique données. Ce montant global est ensuite divisé entre plusieurs agents sous la forme de « droits à polluer », i.e. des droits d’usage sur une portion de nature par l’intermédiaire de la pollution émise.
Troisièmement, la valeur économique totale d’un actif environnemental ne peut se résumer à la seule valeur d’usage. On distingue habituellement deux grandes catégories de valeurs : les « valeurs d’usage actuel » et les « valeurs de préservation » (Arrow et al., 1993, p. 4501). Les « valeurs d’usage actuel » correspondent à des utilisations bien réelles des services délivrés par la nature. Il peut s’agir « d’usages directs » pour les consommateurs (eau potable, cueillette), « d’usages induits » (eau à usage d’irrigation pour l’agriculture, forêt utilisée pour la production de papier) ou « d’usages indirects » (contribution d’un écosystème au maintien d’un microclimat). Les « valeurs de préservation » renvoient, quant à elles, à toutes les valeurs non liées à l’usage actuel. On y trouve les « valeurs d’option » (volonté de se réserver la possibilité d’utiliser un type de service environnemental ultérieurement), les « valeurs d’existence » (Krutilla, 1967, p. 180) pouvant résulter d’une valeur intrinsèque de l’actif (Fisher & Raucher, 1984) ou d’un réflexe altruiste de conservation au profit des générations futures (Mc Connel, 197, p. 30). Toute la difficulté consiste à définir les méthodes appropriées permettant de donner une mesure monétaire de ces valeurs. Dans de très nombreux cas, les estimations proposées concernent les valeurs d’usage des actifs.
Enfin, le but des méthodes d’évaluation monétaire des actifs naturels est d’exprimer en grandeur monétaire une variation de la fonction d’utilité consécutive à une variation de la qualité d’un actif environnemental. Or, comme on vient de le voir, la valeur-utilité n’est pas la seule qui doit être prise en compte dans le cas de la nature. Du coup, les méthodes d’évaluation « oublient » certains effets (préservation des paysages, dégradation de milieux naturels) et sous-estiment régulièrement les coûts collectifs environnementaux et sanitaires (Beaumais & Chiroleu-Assouline, 2004, p. 86). À l’opposé, le choix des individus interrogés peut poser un problème de surévaluation de la valeur des actifs. Dans la plupart des cas, sont interrogés les seuls individus concernés par l’actif environnemental en question. Dans le cas de la zone protégée de l’Annapurna, par exemple, seuls les visiteurs du site ont été interrogés. Ainsi, ne poser la question qu’à des individus ayant une utilité par l’usage régulier d’un actif conduit à surestimer la valeur associée à cet usage. Ajoutons que différentes méthodes appliquées à l’évaluation de la valeur du même actif naturel n’aboutissent pas aux mêmes résultats. Enfin, des réticences d’ordre éthiques sont énoncées à l’encontre de ces évaluations : « Ce qui pose essentiellement problème est l’association d’un étalon monétaire pour attribuer une valeur économique à la vie humaine comme à l’environnement » (ibid., p . 20). Par exemple, les méthodes d’analyse contingente sont de plus en plus utilisées en économie de la santé, notamment en évaluant le prix de la vie humaine. « Peut-on ainsi considérer, sans décrédibiliser le calcul économique, qu’une vie humaine vaut plus ou moins selon une modulation géographique, économique ou encore temporelle ? » (Beaumais, 2002).
On peut donc retenir que la durabilité définie dans le cadre du rapport Brundtland implique la réalisation de deux hypothèses : la substituabilité totale des facteurs et un flux de progrès technique régulier dans le temps. Elle peut être réalisée dans un contexte de croissance économique, de mondialisation, d’augmentation maîtrisée de la démographique, de gestion raisonnée des déchets, à condition d’être en mesure d’évaluer monétairement la valeur des actifs environnementaux.
Le dépassement des deux hypothèses du développement durable conduit à l’émergence de visions alternatives dites « fortes » de la durabilité.
L’émergence d’une durabilité forte « de seuil » et d’une durabilité forte « de rejet »
Il existe au moins deux manières de dépasser les hypothèses de la durabilité faible : la reconnaissance d’un seuil et le rejet total. Dans le premier cas, reconnaître qu’il existe un seuil de « capital naturel critique » sous lequel il n’est pas possible de descendre, constitue une limite forte à la substituabilité entre le capital manufacturé et le capital naturel. C’est l’idée de « substituabilité limitée » qui constitue le socle commun du courant de l’économie écologique (Boisvert et al., 2019). Dans ce cadre, la croissance économique doit être pensée sous contraintes et à l’intérieur de limites écologiques. Ce courant n’implique pas nécessairement de posture radicale, ne préjuge pas le niveau des limites qui devraient être fixées et la manière de repenser la croissance économique pour l’inscrire dans ces limites (Daly & Farley, 2010). Dans le deuxième cas, rejeter totalement l’existence d’une substitution entre le capital manufacturé et le capital naturel conduit à une critique radicale du développement durable. Il ne s’agit plus ici d’inscrire la croissance dans des limites, mais tout simplement de sortir de la croissance elle-même. On parle alors des courant de la décroissance. Nous porterons notre attention sur cette seconde approche de la durabilité forte.
Les auteurs décroissants (se nommant eux-mêmes « objecteurs de croissance ») considèrent que le développement durable ne permet pas d’atteindre la durabilité radicale dont ils se revendiquent. Il lui est reproché, dans sa version Brundtlandienne, de ne pas remettre en cause la société de croissance en relativisant les contraintes imposées par la crise de l’environnement et la crise sociale : « avec le développement durable, on vend de la croissance en la faisant passer pour une protection de l’environnement » (Perrot, 2009, p. 2). Le développement durable apparaît ainsi aux yeux des défenseurs de la décroissance au mieux comme une « opération cosmétique » (Cheynet, 2008, p. 78), un discours qui prescrit « qu’il faut ralentir le cours destructeur de l’économie mondialisée, sans remettre ce cours en question » (Perrot, 2009, p. 2) et au pire comme un « constat d’échec » (Ridoux, 2006, p. 31), une « chimère malfaisante » (Blamont, 2004, p. 18), un « programme anthropophage et dévastateur » (Perrot, 2009, p. 3), une « mythologie programmée » (Perrot et al., 1992, p. 125), « l’un des concepts les plus nuisibles » (Georgescu-Roegen, 1991), un « mot poison » (Cheynet, 2008, p. 64), voire un « oxymore » ou une « antinomie », i.e. une juxtaposition de deux mots contradictoires (Latouche, 2003, p. 23). En conclusion, le développement durable ne serait que la poursuite du développement actuel. Une société de décroissance est alors envisagée comme alternative plausible au système actuel.
Le terme de « décroissance » est probablement mal choisi dans la mesure où une grand partie des auteurs visent une sortie de la croissance pour elle-même. « La décroissance est un terme trop imprécis et ambigu » et d’aucuns préfèrent parler d’« a-croissance » (Van den Bergh, 2011, p. 886). Quoi qu’il en soit, nous retiendrons ici le terme officiel de « décroissance ».
La décroissance : une forme radicale de durabilité forte
Une fois les hypothèses de la durabilité faible rejetées, le courant de la décroissance va s’attacher à définir une nouvelle place pour le travail, à proposer une approche renouvelée du progrès technique et à poser les bases pour un changement de paradigme.
Un contenu nouveau donné à la durabilité
Sur le plan pratique, un contenu nouveau est donné à la durabilité : « simplicité volontaire », autoproduction et localisme, détermination des prix des ressources selon leurs usages en sont les bases.
La « simplicité volontaire » est centrale aux yeux des décroissants car ils considèrent que la société d’abondance n’apporte pas le bonheur espéré. Au contraire, compte tenu des impacts néfastes sur l’environnement, cette société ne peut conduire qu’à une catastrophe générale. L’approche par la « simplicité volontaire » vise à réduire les consommations jugées superflues tout en maintenant celles qui paraissent souhaitables car nécessaires. La décroissance, en tant que projet politique, représente donc une invitation à repenser les modes de consommation. Mais cette volonté de réduction de la consommation s’inscrit dans une perspective particulière : « la décroissance consiste à mener, parallèlement à la lutte contre la misère, un combat contre la richesse matérielle qui s’inscrit lui-même dans la volonté de décroissance des inégalités et aussi la lutte contre les modes de vie ravageurs pour l’environnement » (Cheynet, 2008, p. 105). La modération de la consommation s’inscrit donc dans une perspective de réduction des inégalités sociales et économiques associée à la lutte contre les dégradations de l’environnement. Prôner la simplicité volontaire revient à changer radicalement les modes de vie en commençant par « décoloniser notre imaginaire » selon l’expression de Latouche. L’adhésion à ce virage à 180 degrés ne peut avoir lieu sans que la consommation soit considérée comme une forme d’aliénation, une « arme de destruction sociale ». La simplicité volontaire consiste donc à choisir la sobriété contre une consommation jugée aliénante, destructrice socialement et écologiquement. Dans cette perspective, les objecteurs de croissance préconisent de se débarrasser de la voiture, du téléphone, ou de ne plus faire de courses au supermarché. Est-il utile de préciser, comme l’indique Latouche, que ce choix peut être qualifié d’héroïque dans l’ambiance consumériste dominante ?
Le « localisme » et l’« autoproduction » sont encouragés par les décroissants. Ainsi, la production issue d’un potager cultivé par chacun représente une source non négligeable d’affranchissement de la société de consommation de masse. Cette production en propre autorise des échanges entre individus, ce qui contribue à se dégager du système traditionnel de distribution et de consommation. Cette stratégie est d’ailleurs d’autant plus utile qu’elle permettrait de s’affranchir des dérives consuméristes et en particulier de la publicité. Le mouvement de décroissance s’inscrit dans la lignée des mouvements de critique de la publicité qui dénoncent l’agression perpétuelle qu’elle représente. Le journal La Décroissance est d’ailleurs publié par le mouvement Casseurs de pub. La publicité est critiquée pour l’invasion de l’espace public et de la vie courante (panneaux publicitaires, médias, internet, etc.), mais surtout pour son influence sur le comportement des personnes. Cette stratégie peut également permettre de réorienter les habitudes alimentaires, par exemple en consommant moins de viande et plus de légumes. Cette thèse se justifie, selon elle, par les différences de dépenses d’énergie nécessaire pour produire une calorie d’origine végétale et une d’origine animale. Autrement dit, il est beaucoup moins coûteux du point de vue énergétique de produire des légumes que de la viande. La relocalisation des activités au plus près des lieux d’habitation induit, quant à elle, une sortie des grands centres urbains. Comme le précise Lavignotte, « le problème n’est pas qu’il y a trop d’humains, mais trop d’automobilistes » (Lavignotte, 2010, p. 62).
La « détermination des prix selon les usages », enfin, est introduite par les auteurs décroissants qui y voient un bon moyen d’accéder à la gratuité de certains biens et services : « Le capitalisme s’est fondé sur le respect de la propriété privée. […] L’hyper capitalisme est fondé sur le refus de toute gratuité » (Ariès, 2007, p. 28). Ariès considère que le capitalisme a récemment franchi une étape en cherchant à faire disparaître la gratuité. D’après l’auteur, « la gratuité est un moyen de redéfinir la frontière de l’empire marchand c’est-à-dire un instrument de conquête de l’être sur l’avoir » (Sagot-Duvauroux, 2006, p. 26). Promouvoir la gratuité serait donc le moyen d’endiguer la dérive de la notion de bien-être vers la notion de « bien-avoir ». Cela passe alors par le retour à la notion d’usager préférée à celle de consommateur. L’idée est que le capitalisme a fait émerger le consommateur en cassant les anciens modes de vie et les anciens collectifs. Ce consommateur d’un genre nouveau, « l’usager », dispose d’une capacité de réflexion sur la nécessité de son acte, sur les conséquences collectives de son action et bien évidemment sur la possibilité de définir de bons et de mauvais usages. « Il s’agit donc bien de réinventer un autre mangeur derrière le consommateur de produits alimentaires, de réinventer un nouveau patient derrière le consommateur de soins (para)médicaux, de réinventer un nouvel élève derrière le consommateur de cours, etc. » (Ariès, 2007, p. 35). Ainsi, les gratuités existantes (comme celles de certains services publics), doivent être défendues. En parallèle, le mésusage doit être surtaxé. Des tarifs progressifs pourraient être définis en fonction des niveaux d’utilisation des ressources, un renchérissement en fonction de l’usage. « Pourquoi paierait-on le même prix le litre d’eau pour son ménage et pour remplir sa piscine privée ? Pourquoi payer l’essence le même prix pour se rendre au travail ou en vacances, pour transporter des marchandises ou des humains ? » (ibid., p. 37). Cette approche conduit à une tarification discriminante des biens et des services basée sur la définition des bons et des mauvais usages.
Loin de se présenter comme un corpus unifié, la décroissance s’appuie sur une tradition critique plus ancienne qu’il est possible d’articuler autour de trois grands axes théoriques : une critique du salariat, une critique de la société technicienne et une critique du paradigme « mécaniste » des économistes.
Une nécessaire sortie du salariat
Tous les objecteurs de croissance s’accordent sur deux points : la croissance détruirait plus d’emplois qu’elle n’en crée ; le salariat (87,5 % de la population active dans les pays de l’OCDE en 2019) serait un instrument de domination et d’aliénation du travailleur. Cela les amène à prôner une nécessaire sortie de nos sociétés productivistes afin de donner un statut nouveau au travail. Premièrement, l’objection de croissance reproche à la croissance d’avoir un impact négatif sur l’emploi. A. Gorz, figure de l’écologisme radical des années 1970, est le premier à avoir défendu cette hypothèse. Suivant en cela Marx, cet auteur estime que la croissance, synonyme de poursuite effrénée de gains de productivité sans cesse plus élevés, stimule l’évolution des techniques et ne peut conduire qu’à la réduction du nombre de travailleurs utilisés par le système productif : « plus la productivité du travail augmente, plus faible devient le nombre d’actifs dont dépend la valorisation d’un volume donné de capitaux » (Gorz, 2007, p. 52). En d’autres termes, nos sociétés arrivent à créer toujours plus de richesses en utilisant toujours moins de travailleurs. Dans ces conditions, il devient rigoureusement impossible de rétablir le plein-emploi par une croissance économique quantitative. « L’évolution des techniques semble éliminer l’homme dans tous les domaines », déplore Ariès qui donne, par ailleurs, une liste non exhaustive des dégradations subies par le travail : « la casse des identités professionnelles et des structures de métier, le développement de la précarité (via la multiplication des contrats atypiques), la déqualification rampante des personnels et la baisse relative des salaires, le chômage de masse, etc. » (Ariès, 2007, p. 100). Ces dégradations ne seraient que les signes avant-coureurs de la « fin » ou de « l’abolition » du travail au sein même de nos sociétés dites travaillistes : « nous serions tous des chômeurs en puissance » (ibid., p. 107).
Deuxièmement, le salariat est perçu comme un instrument d’aliénation du travailleur conduisant à tous les excès : « La tragédie du salariat est une longue histoire de dépouillement » (ibid., p. 99). Le travailleur y est dépouillé « de ses instruments de production, du fruit de son travail, de son identité professionnelle, de sa culture de métiers, de son langage, de ses solidarités, de ses collectifs… ». Et l’auteur de conclure finalement que le salariat « n’est imposé que pour le maintenir dans la sujétion » (ibid., p. 99). Avec le salariat, le travailleur perdrait toute liberté d’action autonome. La faute en incombe au capitalisme lui-même et la référence à Gorz est à ce titre à nouveau incontournable. Selon ce dernier, la généralisation progressive du travail salarié dans le capitalisme amène les travailleurs à exécuter des tâches dont ils ne contrôlent ni l’organisation, ni le but. Leurs capacités d’action autonome se trouvent alors réduites, voire annihilées, réduisant finalement leurs libertés de choix à des options simples : consommer ou se divertir ! « Le travail marchandise engendre le pur consommateur dominé qui ne produit plus rien de ce dont il a besoin. L’ouvrier producteur est remplacé par le travailleur consommateur. Contraint de vendre tout son temps, de vendre sa vie, il perçoit l’argent comme ce qui peut tout racheter symboliquement » (Gorz, 2008, p. 134).
Partant de là, le préalable à toute société de décroissance serait de rendre aux individus leurs capacités d’action autonome. Cette position amène notamment les objecteurs de croissance à rejeter vivement toutes les gauches (« gestionnaire », « radicale », « altermondialiste », « keynésienne », etc.) et même le syndicalisme salarial, incapables à leurs yeux de penser autrement le travail que dans une société fondée sur l’identité salariale. Par opposition, le mouvement pour la décroissance prône un changement social « non réductible à un replâtrage du système » (Latouche, 2007, p. 15). Une nécessaire sortie de nos « sociétés travaillistes » constitue pour eux la condition sine qua non de sauvetage du travail. On entend ici par « société travailliste » une société caractérisée par la division du travail et visant à la fois le plein-emploi des facteurs de production et l’amélioration permanente de leur productivité. Toute mesure réduisant « la sphère de nécessité » (i.e. le travail contraint) et favorisant l’expansion de « la sphère de l’autonomie » (le temps libre) va dans le bon sens. Ainsi, les objecteurs de croissance sont plutôt favorables à la réduction du temps de travail (RTT) ou à la mise en place d’un revenu minimum garanti. Gorz lui-même est connu pour ses prises de positions en faveur de la RTT qu’il comparait à un « nouveau contrat social » (Gorz, 1991, ch. 9). Mais, pour lui comme pour ses successeurs, ces mesures ne sont pas suffisantes pour « libérer » l’individu des contraintes qui pèsent sur lui dans la société travailliste. « La question fondamentale n’est donc pas le nombre exact d’heures nécessaires, mais la place du travail comme “valeur” dans la société » (Latouche, 2007, p. 18). Or, cette nouvelle place du travail ne peut être trouvée qu’au terme d’un processus de « démarchandisation » de ce dernier (Latouche) ou encore de sortie de la division du travail (Ariès). On débouche alors sur la société de décroissance, située au-delà des rapports marchands.
Sortir du mythe du progrès technique
Tous les objecteurs de croissance se prononcent contre la « société technicienne » selon l’expression d’Ellul. Cet auteur n’a eu de cesse de dénoncer l’importance prise par les techniques dans nos sociétés et ses travaux ont considérablement influencé le discours de l’objection de croissance. Les arguments avancés peuvent être résumés en trois points.
Premièrement, Ellul distingue la technique de la machine : la première étant une méthode en vue d’un résultat, un agencement de moyens en vue d’atteindre une fin tandis que la seconde n’est qu’un appareil servant à effectuer certaines tâches. Il apparaît alors que le domaine d’application de la technique dépasse très largement celui de la machine. La science elle-même serait, selon l’auteur, « devenue un moyen de la technique » (Ellul, 1954, p. 224).
Deuxièmement, Ellul fait une distinction entre l’« opération technique » et le « phénomène technique » et défend l’idée que « le phénomène technique actuel n’a rien de commun avec les techniques des sociétés antérieures » (Ellul, 1988, p. 267). L’opération technique correspond à tout travail (complexe ou simple) réalisé en suivant une méthode donnée dans le but d’atteindre un résultat (tailler un silex, tanner une peau, piloter un avion, conduire une machine, etc.). Chaque société a toujours déterminé les opérations techniques en fonction de ses besoins mais aussi en fonction de ses valeurs. De tout temps, il est arrivé que des techniques soient volontairement réfrénées ou abandonnées. Toutefois, l’époque moderne se caractériserait selon Ellul, par une « prise de conscience » des avantages que l’on peut tirer de techniques de plus en plus performantes et par une recherche systématique de l’« efficacité maximale ». On bascule alors dans le « phénomène technique », c’est-à-dire une situation dans laquelle la technique est érigée au rang de valeur suprême par la volonté collective et ce, au détriment de toutes les autres valeurs humaines.
Troisièmement, le phénomène technique acquiert progressivement de nouvelles caractéristiques comme « l’autonomie, l’unité, l’universalité, la totalisation, l’auto-accroissement, l’automatisme, la progression causale et l’absence de finalité » (ibid., p. 56). Dès lors, la nécessité d’un perfectionnement incessant des techniques s’enchaîne d’elle-même, tuant ainsi progressivement toute autre option. Les techniques phagocytent progressivement toutes les sphères du vivant et finissent par s’engendrer elles-mêmes en dehors de toute finalité autre que celle de l’efficacité optimale. La conséquence ultime de cette « autonomie autoréférentielle » du phénomène technique est la constitution d’un « système technique », c’est-à-dire d’une sorte de mise en relation de toutes les techniques constituant un réseau objectif, autonome et indépendant : « Le système est lui-même composé de sous-systèmes : système ferroviaire, postal, téléphonique, aérien, système de production et distribution de l’énergie électrique, processus industriel de production automatisée, etc. Ces sous-systèmes se sont organisés, adaptés, modifiés progressivement afin de répondre aux exigences provenant entre autres de la croissance de la dimension de ces sous-systèmes, et de la relation qui s’établissait peu à peu avec les autres » (Ellul, 1977, p. 56). Le système technique devient « l’élément enveloppant à l’intérieur duquel se développe notre société ». Les techniciens ne disposent plus que de connaissances parcellaires sur le système total et ne peuvent chacun en appréhender qu’une toute petite partie. L’homme lui-même devient un simple rouage au service du système : « il n’y a pas d’autonomie de l’homme possible face à l’autonomie de la technique » (Ellul, 1954, p. 126). L’informatique enfin, par sa capacité même à tisser des liens entre toutes les techniques, constitue d’après l’auteur la technique autorisant « l’achèvement du système ». On atteint alors une société dans laquelle l’ordre technique détient le contrôle social absolu, dans laquelle « nous n’avons plus rien à perdre et plus rien à gagner, nos plus profondes impulsions, nos plus secrets battements de cœur, nos plus intimes passions sont connues, publiées, analysées, utilisées. L’on y répond, l’on met à ma disposition exactement ce que j’attendais et le plus suprême luxe de cette civilisation de la nécessité, est de m’accorder le superflu d’une révolte stérile et d’un sourire consentant » (ibid., p. 388). Enfin, Ellul dénonce l’avènement d’un « discours séducteur des techniques » relevant d’un « bluff technologique » qui vise à favoriser l’adhésion de tous au système technicien afin d’en faciliter l’expansion.
Toutefois, alors qu’il y a un certain fatalisme chez Ellul pour qui l’achèvement du système technique est inéluctable, il y a chez les objecteurs de croissance l’idée qu’il est possible de dévier le cours du système technicien car, selon Latouche, « la mégamachine n’est pas un monstre en apesanteur, elle est solidement ancrée à notre imaginaire » (Latouche, 2004, p. 32). C’est pour cette raison que les tenants de la décroissance appellent à sortir du mythe du progrès technique : « Décoloniser cet imaginaire est une tâche urgente à accomplir pour neutraliser les dangers potentiels de cette créature dès lors qu’elle menace de se retourner contre son créateur » (ibid., p. 32).
Un nouveau paradigme pour penser la durabilité
D’après Besson-Girard, « c’est précisément sur le registre de ces croyances que les objecteurs de croissance fondent leur combat contre la dictature de l’économisme » (Besson-Girard, 2007, p. 5). En d’autres termes les objecteurs de croissance ne voient pas le monde de la même manière, ne croient pas aux mêmes choses et, en un mot, ne partagent pas le même « paradigme » que les économistes. Quelles sont donc les spécificités des paradigmes en présence et surtout qu’est-ce qui les oppose autant ? C’est Georgescu-Roegen qui répond le premier à cette interrogation dans Demain la décroissance, son ouvrage phare publié en 1979 et dans lequel l’auteur va poser les bases de ce qu’il nomme la bioéconomie[3].
Georgescu-Roegen constate que le paradigme des économiste repose sur la mécanique newtonienne. Le processus économique dans son ensemble est toujours pensé comme un modèle économique autonome et se suffisant à lui-même : « preuve en est — et elle est éclatante — la représentation dans les manuels courants du processus économique par un diagramme circulaire enfermant le mouvement de va-et-vient entre la production et la consommation dans un système complètement clos » (Georgescu-Roegen, 1979, p. 65).
L’école néoclassique, qui prétend faire de la science économique « la mécanique de l’utilité » (Jevons, 1871) est particulièrement visée par ce constat. Mais les économistes marxistes n’échappent pas non plus à ce biais puisque leur fameux diagramme de reproduction introduit par Marx représente également le processus économique comme un mouvement parfaitement circulaire et déconnecté de l’écosystème naturel. Ce premier constat explique donc pourquoi les objecteurs de croissance contemporains ont tendance à mettre « tous les économistes dans le même sac » et à considérer que la science économique (toutes théories confondues) présente la fâcheuse tendance de vivre « hors sol » (Cheynet, 2008, p. 18). Tout l’objet de la bioéconomie consiste alors à remettre les économistes les pieds sur Terre, c’est-à-dire à repenser les croyances sur lesquelles repose la science économique dans son ensemble. En ce sens, l’effort de Georgescu-Roegen peut être rapproché de celui des approches évolutionnistes qui proposent pour leur part une « reconnexion avec des thèmes issus de la biologie moderne » (Chavance, 2007, p. 95). C’est ainsi que Hodgson, par exemple, affirme que le darwinisme « contient une ontologie puissante » susceptible de « ramener la vie dans la science économique » (Hodgson, 1993, p. 54).
Pour sa part, Georgescu-Roegen se propose de reconstruire le paradigme de l’économie sur la base de la thermodynamique et non plus de la mécanique. Pour ce faire, l’auteur est d’abord contraint de déconstruire « l’un des mythes les plus tenaces » des économistes consistant à croire qu’« il convient de mesurer les ressources en termes économiques, et non point en termes physiques » (Georgescu-Roegen, 1979, p. 101). Au contraire, il considère que les ressources physiques doivent en priorité être mesurées en termes physiques. L’auteur rappelle alors les deux lois de la thermodynamique. La première est une « loi stricte de conservation » qui garantit que dans tout système isolé (comme l’est la Terre par exemple) la quantité de matière et d’énergie reste constante. Selon cette loi, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Cette première loi permet que tout processus (y compris économique) « puisse avoir lieu dans un sens ou dans l’autre, de telle sorte que tout le système revienne à son état initial, sans laisser aucune trace de ce qui est advenu » (ibid., p. 95). La deuxième loi, dite de l’entropie, introduit une distinction nouvelle entre énergie utilisable et énergie inutilisable. La loi est élargie à la matière par Georgescu-Roegen. Tout processus (y compris économique), rendu possible par la première loi, transforme de manière irréversible de l’énergie et de la matière utilisables (dites de basse entropie) en énergie et matière inutilisables (dites de haute entropie). « Un flux entropique est simplement un flux dans lequel la matière et l’énergie deviennent moins utiles » (Daly & Farley, 2010, p. 29). L’entropie du système, lorsque celui-ci est isolé (comme l’est la planète Terre), augmente alors continuellement et irrévocablement vers un maximum qui correspond à une situation où toute l’énergie et la matière utilisable et accessible ont complètement disparu. « En conséquence, le destin ultime de l’univers n’est pas la “Mort Thermique” (comme on l’avait d’abord cru) mais un état plus désespérant : le Chaos » (ibid., p. 96).
Héritiers de la pensée de Georgescu-Roegen, les objecteurs de croissance contemporains adoptent le paradigme thermodynamique, ce qui les amène à rejeter la croissance économique du fait même des limites physiques de la Terre.
Les limites de la décroissance
Si la proposition de la décroissance consistant, comme le dit Cheynet, à « réinsuffler dans la société de l’esprit critique face à la pensée dogmatique et aux discours de propagande », paraît à première vue souhaitable, le passage à sa mise en œuvre individuelle et collective, en matière de consommation, semble plus problématique. En définitive, les approches pour la décroissance rencontrent plusieurs limites d’ordre théorique et pratique qui en réduisent finalement l’impact sur le concept de durabilité. Les principales limites des approches prônant la décroissance sont : des solutions difficiles à mettre en œuvre ; une vision simplifiée des régimes de croissance ; une absence de réflexion sur la notion de changement systémique ; une lecture erronée de la loi de l’entropie.
Des solutions difficiles à mettre en œuvre
Comme l’indiquent les objecteurs de croissance eux-mêmes, la décroissance ne propose pas de système « clés en main », mais une série de solutions (présentées précédemment). Or ces solutions apparaissent difficiles à atteindre. La simplicité volontaire, par exemple, ne cherche pas à stopper toute forme de consommation, mais à redéfinir les comportements de consommation. Or les pays du Nord doivent accepter de réviser à la baisse leurs modes de vie, ce qui est loin d’être réalisable : « L’idée que le sauvetage de la planète doit nécessairement se traduire par un puissant serrage de ceinture au Nord ne peut susciter qu’un enthousiasme très modéré parmi ceux qui n’ont pas le sentiment d’être aujourd’hui des privilégiés qui gaspillent de façon éhontée l’énergie et les matières premières » (Duval, 2004, p. 5).
Ce défi d’une rééducation des consommateurs peut apparaître utopique dans des sociétés dans lesquelles la consommation dépasse la simple satisfaction de besoins et où elle est devenue un phénomène social et culturel. Le localisme et l’autoproduction, présentés par les objecteurs de croissance comme des sources d’affranchissement de la société de consommation, portent en eux une contradiction. Sortir de l’agriculture « productiviste », qui mobilise en France 3 000 m² pour nourrir un habitant (Gaigne, 2011, p. 97), pour aller vers une agriculture fractionnée composées de jardins cultivés privés ou communautaires (moins productifs), impliquerait automatiquement un étalement et donc un éloignement accru entre les individus-jardiniers avec finalement plus de distance à parcourir pour procéder aux échanges. Dans le contexte d’urbanisation croissante qui caractérise nos sociétés, localisme et autoproduction apparaissent difficiles à atteindre. Pour qu’une ville comme Paris, par exemple, puisse accéder à l’autosuffisance, il faudrait qu’elle s’étale sur soixante fois sa surface actuelle… (Bourdeau-Lepage & Vidal, 2012, p. 207). Comme le soulignent Bourdeau-Lepage et Vidal, « partagés — mais partagés par tous — les jardins communautaires urbains ne pourraient répondre que d’une manière très anecdotique aux besoins alimentaires de la totalité des citadins » (ibid., p. 207).
Une vision simplifiée des régimes de croissance
La recherche effrénée de croissance, qui caractérise le développement actuel, est considérée par les objecteurs de croissance comme la source de tous les maux : aggravation des inégalités entre pays et au sein même de chacun d’entre eux, paupérisation des classes moyennes là où elles existent, rupture des liens sociaux, insensibilisation de l’individu aux problèmes des autres (proches ou lointains), course à l’hypercompétitivité avec « accélération des rythmes, délocalisations, flexibilité, chômage, précarisation, etc. » (Ridoux, 2006, p. 31). Pour sortir de ces maux, une seule issue logique semble aller de soi : la décroissance ! Le changement envisagé s’apparente à une transition à partir d’un point de départ unique et connu (la croissance), vers un point d’arrivée unique et connu (la décroissance). S’inspirant d’Illitch, Latouche propose d’aller jusqu’à la suppression de l’aide publique au développement (APD) car elle véhiculerait des idéaux de croissance dans les PED. Toutefois, le raisonnement des objecteurs de croissance exposé ci-dessus pose au moins deux problèmes. D’une part, il repose sur une vision étroite du concept de croissance, et d’autre part les maux décrits ne sont pas uniquement liés à la croissance.
Premièrement, la croissance « démesurée » décrite par les objecteurs de croissance, basée sur le « productivisme à tout crin », sur « la folle concurrence de tous contre tous » et sur la « logique d’accumulation sans limite » est plus largement inscrite dans un modèle de capitalisme de type libéral lui-même caractérisé par la primauté donnée au marché, la recherche permanente de flexibilité, l’ouverture systématique aux échanges extérieurs et la préférence pour la propriété privée. Or, ce modèle de capitalisme n’est pas exclusif sur la planète et « coexiste », pour ainsi dire, avec d’autres modèles. Il est possible ainsi d’opposer « capitalisme anglo-saxon » et « capitalisme rhénan » (Albert, 1991, p. 48) ou bien « économies de libre-marché » et « économies coordonnées de marché » (Hall & Soskice, 2001, p. 1-68) ou bien encore capitalismes « de libre marché », « européen », « social-démocrate », « asiatique » et « méditerranéen » (Amable, 2005, p. 34). L’intérêt de ces typologies est de montrer que chaque variante de capitalisme est caractérisée par une combinaison particulière de critères (degré de concurrence, rapport salarial, place du secteur financier, importance de la protection sociale et du système éducatif). « La » croissance est donc « plurielle » et présente des profils particuliers en fonction des modèles de capitalisme dans laquelle elle est appréhendée. Elle peut être mesurée ou démesurée, redistributive ou génératrice d’inégalités, protectrice ou destructrice de l’emploi, à l’origine d’externalités négatives et positives, etc. Tout dépend finalement de la combinaison institutionnelle dans laquelle elle est enchâssée. L’économie est « un processus institutionnalisé » (Polanyi, 1957, p. 244), c’est-à-dire qu’elle est toujours encastrée (ou englobée) dans des institutions économiques et non économiques. Comme le rappelle Chavance, « l’étude des questions économiques les plus diverses peut difficilement faire abstraction de l’importance des institutions » (Chavance, 2007, p. 99).
Deuxièmement, si la croissance peut avoir des qualités, les maux décrits par les auteurs en faveur de la décroissance ne sont pas issus de la seule croissance. Ils sont le résultat d’une multitude de causes : l’aggravation des inégalités peut trouver son origine dans un rapport salarial défavorable à certaines catégories de la population (femmes, jeunes, non diplômés, personnes handicapées, etc.) ; la paupérisation et la rupture des liens sociaux peuvent résulter d’un affaiblissement des systèmes redistributifs ; l’épuisement accéléré des ressources naturelles peut provenir du comportement opportuniste des agents en matière d’environnement. D’une manière générale, les maux décrits par les objecteurs de croissance sont davantage imputables à des choix politiques qu’à la croissance elle-même qui en découle, ce que reconnaissent finalement certains d’entre eux : « La condition de la solidarité relève non pas de l’accroissement de la richesse mais clairement de choix de société » (Cheynet, 2008, p. 26). Les objecteurs de croissance ne s’opposent donc pas à la croissance dans l’absolu, mais à une organisation sociale particulière qui donne la primauté au marché sur l’État, à l’ouverture commerciale et à la propriété privée. De ce point de vue, leur approche est essentielle car elle permet de penser un autre monde, mais précisément, elle n’est pas la seule. D’autres courants critiques proposent également des issues alternatives à cette situation : courants altermondialistes, écologistes, institutionnalistes pour ne citer que ceux-là.
Le flou du changement systémique
L’une des faiblesses majeures du mouvement de la décroissance réside dans l’absence de scénario de transition. Sur la question du « comment faire ? », les réponses des objecteurs de croissance sont peu nombreuses et vagues au regard de l’enjeu crucial que représente la sortie d’un système d’organisation sociale. Parrique identifie trois attitudes possibles (opposition, réformisme et construction d’alternatives), déclinées en « 3 buts politiques, 39 objectifs politiques et 27 instruments politiques au total » (Parrique, 2019, p. 493). Et l’auteur de conclure que « le défaut le plus important de ces politiques est qu’elles sont vagues » (ibid, p. 496). « Jusqu’à présent, la décroissance n’a pas offert de recommandations politiques convaincantes. Le programme est vague, disparate, désordonné, figé, flou et abstrait, c’est-à-dire qu’il n’est pas assez solide pour être appliqué » (ibid., p. 500). En effet, les pistes esquissées par les auteurs décroissants négligent des aspects fondamentaux des phénomènes de transition. Tout phénomène de changement systémique (voulu ou subi) correspond à une mutation des formes institutionnelles (formelles et informelles) autant déterminée par les acteurs ayant le pouvoir de fixer les nouvelles règles (path-shaping) que par l’héritage du passé (path-dependency), des situations de « blocages » (lock-in) et de « trouvailles systémiques » étant fréquentes. Outre le caractère fortement utopique des objectifs des auteurs en faveur de la décroissance, les problèmes de la transition évoqués ci-dessus sont complètement ignorés ou sous-estimés. Pourtant, un auteur comme Marx, qui avait également une vision utopique de la société nouvelle à atteindre, mettait en garde sur le fait que « ce à quoi nous avons à faire ici, c’est à une société communiste non pas telle qu’elle s’est développée sur les bases qui lui sont propres, mais au contraire, qui, sous tous les rapports économique, moral, intellectuel, porte encore les stigmates de l’ancienne société des flancs de laquelle elle est issue » (Marx, 1875, p. 5).
Une marge de liberté pour la croissance
La deuxième loi de la thermodynamique est utilisée par les objecteurs de croissance pour invalider la vision « faible » du développement durable : « aucun système économique ne peut survivre sans un apport continue d’énergie et de matière » (Georgescu-Roegen, 1979, p. 182). La fin est inéluctable donc, mais il y a, et c’est toute la subtilité de cette seconde loi de la thermodynamique, une incertitude quant à la survenue de cet état de dissipation totale de la matière. Georgescu-Roegen lui-même admet que ce n’est qu’« à long terme ou à l’échelle immense de la “machine du monde” que la dissipation de matière atteint des proportions sensibles » (ibid., p. 177). Ne peut-on pas alors considérer, à l’instar de Godard, que « si l’impossibilité identifiée ne devait se manifester que dans 20 000 ans, serait-ce bien utile aux générations présentes, qui ont à penser et déterminer aujourd’hui leur action, de savoir qu’asymptotiquement l’idée de croissance devra être amendée dans plusieurs millénaires ? » (Godard, 2005, p. 20). Bien entendu, le terme « développement durable » est probablement mal choisi car rien ne saurait être durable sur Terre. Il en va d’ailleurs de même pour le terme « décroissance », car une décroissance sans fin n’a pas plus de sens : « L’erreur cruciale consiste à ne pas voir que non seulement la croissance, mais même un état de croissance zéro, voire un état décroissant qui ne tendrait pas à l’annihilation, ne saurait durer éternellement dans un environnement fini » (Georgescu-Roegen, 1979, p. 126).
Conclusion
La vision « faible » de la durabilité se démarque par son souci de concilier efficacité économique, respect des actifs naturels et répartition équitable des richesses. Son talon d’Achille repose sur des hypothèses sous-jacentes peu réalistes : substituabilité des facteurs (Solow, Hartwick), nouvelle ère de progrès technique (Brundtland). Cette vision « faible » de la durabilité se heurte à une série de problèmes qui en limite finalement la portée : contradiction entre durabilité et mondialisation, entre durabilité et croissance démographique, entre durabilité et réduction des déchets, entre durabilité et évaluation monétaire des actifs naturels.
A l’opposé, le mouvement en faveur de la décroissance, s’appuie sur une tradition critique ancienne du capitalisme portant sur le salariat (Gorz, Illitch), le progrès technique (Ellul) et le paradigme « mécaniste » des économistes (Georgescu-Roegen). Cependant cette vision « forte » radicale ne surmonte pas, pour l’heure, de nombreux impensés : propositions difficiles à mettre en œuvre, non prise en compte de la notion de « régime » de croissance, absence de réflexion sur la question de la transition systémique, lecture contestable de la loi de l’entropie… Malgré ces limites, le discours pour la décroissance n’est pas sans impact sur la vision « faible » de la durabilité comme l’attestent l’émergence de la notion de décroissance « sélective », l’économie de la fonctionnalité et la recherche de nouveaux indicateurs de richesse. Au regard de l’urgence à réagir face aux menaces que fait peser un capitalisme débridé sur les écosystèmes, il est fort probable que ces deux visions extrême de la durabilité feront émerger un éventail d’actions adaptées à la situation.
Bibliographie
Albert Michel (1991). Capitalisme contre capitalisme. Paris, Seuil.
Amable Bruno (2005). Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation. Paris, Seuil.
Ariès Paul (2007). « La dégradation du travail productif ». Entropia, 2, pp. 98-110.
URL : https://www.entropia-la-revue.org/spip.php?article163
Arrhenius Svante (1896). « On the influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground ». Philosophical Magazine and Journal of Science, Series 5, 41(251), pp. 237-276 [republié en 2009 par Taylor & Francis online]. DOI : doi.org/10.1080/14786449608620846
Arrow K., Leamer E., Portney P., Radner R., Schuman H., Solow R. (1993). « Report of the NOAA panel on contingent valuation ». Federal Register, 58, pp. 4501-4514.
Ballet Jérôme & de Bry Françoise (2001). L’entreprise et l’éthique, Paris : Seuil, coll. Points.
Beaumais Olivier (2002). Économie de l’environnement : méthodes et débats. Paris, La Documentation française.
Beaumais Olivier & Chiroleu-Assouline Mireille (2004). Économie de l’environnement. Paris, Bréal.
Bensebaa Faouzi & Boudier Fabienne (2008). « Gestion des déchets dangereux et responsabilité sociale des firmes : le commerce illégal de déchets électriques et électroniques ». Développement Durable et Territoires, Varia (2004-2010), pp. 1-16.
DOI : doi.org/10.4000/developpementdurable.4823
Besson-Girard Jean-Claude (2007). « Décroissance et travail », Entropia, 2, pp. 2-7.
URL : https://www.entropia-la-revue.org/spip.php?article152
Blamont Jacques (2004). Introduction au siècle des menaces. Paris, Odile Jacob.
Boisvert Valérie, Carnoye Leslie & Petitimbert Remy (2019). « La durabilité forte : enjeux épistémologiques et politiques, de l’économie écologique aux autres sciences sociales ». Développement durable et territoires, 10(1). DOI : doi.org/10.4000/developpementdurable.13837
Bourdeau-Lepage Lise & Vidal Roland (2012). « Nature urbaine en débat : à quelle demande sociale répond la nature en ville ? ». Le Demeter 2012, pp. 293-306. URL : hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-00950697
Bourg Dominique (2002). Quel avenir pour le développement durable ? Paris, éd. Le Pommier.
Brundtland Gro Harlem (1987). Notre avenir à tous. CMED, ONU, 349 p. [publié en ligne sur le site du ministère français des Affaires étrangères].
Chavance Bernard (2007). L’économie institutionnelle. Paris, La Découverte.
Cheynet Vincent (2008). Le choc de la décroissance. Paris, Seuil.
Daly Hermann E. & Ferley Joshua (2010). Ecological Economics: principles and applications. Washington, Island Press [2nd edition].
Duval Guillaume (2004). « Développement durable : la maison brûle… », Alternatives Économiques, Hors-série n° 63, pp. 3-8.
Ellul Jacques (1954). La technique ou l’enjeu du siècle. Paris, Armand Colin.
Ellul Jacques (1977). Le système technicien. Paris, Calman-Lévy.
Ellul Jacques (1988). Le Bluff technologique. Paris, Hachette.
Erkman Suren (2004). Vers une écologie industrielle. Paris, éd. Charles Léopold Mayer.
Fisher Ann & Raucher Robert (1984). « Intrinsic benefits of improved water quality: conceptual and empirical perspectives ». Advances in Applied Microeconomics, vol. 4. Greenwich Conn. (États-Unis), JAI Press.
Gaigné Carl (2011). « Urbanisation et durabilité des systèmes alimentaires ». In Rapport duALIne. Durabilité de l’alimentation face à de nouveaux enjeux. Questions à la recherche (coord. : Esnouf C., Russel M. & Bricas N.). Rapport INRA-CIRAD (France), pp. 97-112. URL : https://hal.inrae.fr/hal-02810457/document
Georgescu-Roegen Nicholas (1979). La décroissance, entropie-écologie-économie. Paris, Le sang de la terre [réed. 2008].
Georgescu-Roegen Nicholas (1991). « Correspondance avec John Berry ». Cité par Mauro Bonaïuti (2001), La teoria bioeconomica. La « nuova economia » di Nicholas Georgescu Roegen. Rome, Carocci, p. 53.
Godard Olivier (2005). « Le développement-durable, une chimère, une mystification ». Mouvements, 41, pp. 14-23. DOI : doi.org/10.3917/mouv.041.0014
Gorz André (1991). Capitalisme, socialisme, écologie. Désorientations, orientations. Paris, Galilée.
Gorz André (2007). « Crise mondiale, décroissance et sortie du capitalisme ». Entropia, 2, pp. 51-59.
Gorz André (2008). Ecologica. Paris, Galilée.
Hall Peter A. & Soskice David (2001). « An Introduction to Varieties of Capitalism », In Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage (P. A. Hall and D. W. Soskice eds). Oxford, Oxford University Press, pp. 1-68.
Hartwick John M. (1977). « Intergenerational Equity and Investing of Rents from Exhaustible Resources ». American Economic Review, 67, pp. 972-974.
Hodgson Geoffrey M. (1993). Economics and Evolution: Bringing Life Back Into Economics. Cambridge (UK) and Ann Arbor, Michigan, Polity Press and University of Michigan Press.
Jevons William Stanley (1871). The Theory of Political Economy. London, McMillan.
Krutilla John V. (1967). « Conservation reconsidered ». American Economic Review, 57, pp. 777-786.
Latouche Serge (2007). « Décroissance, plein emploi et sortie de la société travailliste », Entropia, 2, pp. 11-23.
Latouche Serge (2003). « L’imposture du développement durable ou les habits neufs du développement ». Mondes en développement, 31(1), pp. 23-30.
Latouche Serge (2004). La Mégamachine. Paris, La découverte/MAUSS.
Lavignotte Stéphane (2010). La décroissance est-elle souhaitable ? Paris, Textuel.
Marx Karl (1875). Critique du programme de Gotha. Paris, Les éditions sociales, coll. GEME [éd. 2008].
McConnell Kenneth E. (1997). « Does altruism undermine existence value? », Journal of Environmental Economics and Management, 32, pp. 22-37. DOI : doi.org/10.1006/jeem.1996.0944
Mirkin Barry & Weinberger Mary Beth (2001). The Demography of Population Ageing. New York, Population Division, United Nations Secretariat.
Myrdal Gunnar (1958). Une économie internationale. Paris, PUF.
Parrique Timothée (2019). The political economy of degrowth. Thèse de doctorat d’économie, Université Clermont Auvergne (France)/Stockholm universitet (Suède).
Perrot Marie-Dominique (2009). « Décroire pour décroître ». Passerellesud.org [en ligne]
Perrot Marie-Dominique, Rist Gilbert, Sabelli Fabrizio (1992). La Mythologie programmée : l’économie des croyances dans la société moderne. Paris, PUF.
Point Patrick (1998). « La place de l’évaluation des biens environnementaux dans la décision publique », Économie publique, n° 1, pp. 13-44. DOI : doi.org/10.4000/economiepublique.2141
Polanyi Karl (1975). « L’économie en tant que procès institutionnalisé ». In Les systèmes économiques dans l’histoire et dans la théorie (dir. : Polanyi K. & Arensberg C.). Paris, Larousse, pp. 239-260 [éd. originale 1957].
Prieto Marc & Slim Assen (2009). « Évaluation des actifs environnementaux : quels prix pour quelles valeurs ? ». Management & Avenir, 28, pp. 20-38. DOI : doi.org/10.3917/mav.028.0018
Ridoux Nicolas (2006). La décroissance pour tous. Paris, Parangon.
Sagot-Duvauroux Jean-Louis (2006). De la gratuité. Paris, L’Éclat.
Solow Robert M. (1974). « The Economics of Resources or the Resources of Economics ». American Economic Review, 64(2), pp. 1-14.
Solow Robert M. (1986). « On the Intergenerational Allocation of Natural Resources ». The Scandinavian Journal of Economics, 88(1), pp. 141-149.
Stiglitz Joseph (2002). Globalization and its discontents. New York, Norton & Company.
UN (1992). Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-12 June, 351 pages.
Van Den Bergh Jeroen (2011). « Environment versus growh – A criticism of “degrowth” and a plea for “a-growth” ». Ecological Economics, 70(5), pp. 881-890.
Notes
[1] Il existe un débat sur la manière de traduire « sustainable » en français. Alors que « viable » aurait été une traduction plus fidèle, le terme « durable » s’est finalement imposé. Ce débat sémantique ne change en rien le contenu du concept ainsi que les problématiques qui lui sont associées. Aussi, il n’en sera pas fait état dans cet article.
[2] Centre d’actualité de l’ONU. Site consulté le 20/10/2021.
[3] Voir dans ce numéro, du même auteur, l’article « Portrait d’un précurseur de la décroissance. Nicholas Georgescu-Roegen et la bioéconomie ».
Auteur / Author
Assen SLIM est économiste, professeur et directeur de recherche à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à Paris, France. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses centres de recherche sont le CREE (EA4513) et le CESSMA (UMR245). Les thèmes de recherche du Dr Slim portent sur la transition post-socialiste, l’économie internationale, l’économie de l’environnement et la durabilité.
Assen SLIM is an economist, professor and director of research at the National Institute of Oriental Languages and Civilizations (INALCO) in Paris, France. He holds a Ph.D in Economics from the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Its research centers are CREE (EA4513) and CESSMA (UMR245). Dr Slim’s research themes focus on post-socialist transition, international economics, environmental economics and sustainability.
Résumé
Cet article compare deux visions opposées de la durabilité. D’un côté, une durabilité reposant sur une « nouvelle ère de croissance économique », selon l’expression de Brundtland, et une croissance dite « verte » et « inclusive » constitue la vision faible de la durabilité. Elle repose sur deux hypothèses : la substituabilité capital/ressources naturelles et le progrès technique. De l’autre côté, une durabilité basée sur la « décroissance » selon l’expression de Georgescu-Roegen. Il s’agit alors de tenir compte des lois de la thermodynamique, et en particulier celle de l’entropie qui introduit des irréversibilités. L’article se propose d’expliciter ces deux acceptions de la durabilité, d’en discuter les apports et les limites et de montrer enfin qu’il n’existe pas une seule solution de durabilité applicable à tous. Alors que certains pays ont un besoin vital de croissance afin de s’inscrire dans une trajectoire vertueuse de développement, d’autres au contraire auraient toutes les raisons de décélérer.
Mots clés
Durabilité faible – Durabilité forte – Économie verte – Décroissance.
Abstract
This article compares two opposing visions of sustainability. On the one hand, sustainability based on a ‘new era of economic growth’, as Brundtland put it, and so-called ‘green’ and ‘inclusive’ growth is the weak vision of sustainability. It is based on two assumptions: capital/natural resource substitutability and technical progress. On the other hand, a sustainability based on ‘degrowth’, as Georgescu-Roegen puts it. It is then a question of taking into account the laws of thermodynamics, and in particular the law of entropy, which introduces irreversibilities. The article sets out to explain these two meanings of sustainability, to discuss their contributions and limitations, and to show that there is no single sustainability solution that can be applied to all. While some countries have a vital need for growth in order to follow a virtuous development path, others have every reason to slow down.
Key words
Low sustainability – High sustainability – Green economy – Degrowth.